Premières initiatives féministes

Jusqu’au XIXe siècle, les femmes espagnoles, souvent analphabètes, vivent dans l’ombre de leur père puis de leur époux. Il faut attendre la fin de ce siècle pour qu’elles commencent à se mobiliser afin de revendiquer leurs droits, notamment en lançant le mouvement suffragiste et en créant en 1870 la « Asociación para la Enseñanza de la Mujer » (Association pour l’Enseignement de la Femme).
Le début du XXe siècle et les premières revendications

Ce n’est vraiment qu’au début du XXe siècle qu’elles vont entreprendre de nombreuses actions pour faire éclater le système patriarcal qui les avilit. Les premières organisations dirigées par des femmes voient le jour pour faire avancer leurs droits et leurs libertés. La première manifestation dirigée par Angeles Lopez de Ayala (photo G.), et menée par des femmes en Espagne, se déroule à Barcelone le 10 juillet 1910. Elles réclament les mêmes droits politiques que les hommes.
En 1918 naît officiellement la « Asociación Nacional de Mujeres Españolas » (Association Nationale des Femmes Espagnoles) qui défend, entre autres, les réformes du Code Civil, la promotion éducative des filles et le droit des femmes à exercer une profession libérale.
Parallèlement les artistes se mobilisent au sein du groupe « las Sinsombrero » (les sans chapeau) qui revendique un rôle collectif mais également individuel pour la femme. Ce groupe est notamment à l’origine de la féminisation des noms de profession.
Dans les années 20 se produisent les premières revendications sur le plan européen qui conduisent à la reconnaissance du droit de vote des femmes et à la possibilité pour les femmes espagnoles d’être élues aux Assemblées de la Seconde République.
Les premières élues au Congrès espagnol sont Clara Campoamor, Margarita Nelken et Victoria Kent. (photos de G à D)


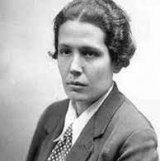
En 1931, la Constitution espagnole de la Seconde République est approuvée et établit les mêmes droits électoraux pour les hommes et les femmes. Le 19 novembre 1933, les femmes espagnoles acquièrent le droit de vote pour la première fois aux élections générales.
Le 25 décembre 1936, l’avortement est autorisé gratuitement en Catalogne jusqu’à douze semaines de grossesse.
Malheureusement, en 1939, à la fin de la guerre d’Espagne, l’arrivée du franquisme va balayer d’une main tous ces acquis.
Franco et le retour au patriarcat
Une véritable politique d’épuration à l’encontre des féministes est déployée par le gouvernement et de nombreuses activistes doivent alors s’exiler au Mexique, aux États-Unis ou en France.
Le régime de Franco interdit les institutions féministes. Elles sont ainsi démantelées et remplacées par des organisations en accord avec les idées nationalistes du gouvernement. À leur tête sont placées des femmes appartenant à la Phalange, organisation nationaliste combattant tout militant révolutionnaire et dont la branche féminine s’inscrit dans une vision très conservatrice du rôle de la femme (celle-ci doit rester soumise aux hommes et se consacrer uniquement au foyer).
Les valeurs sociales et juridiques espagnoles de l’ère Franco établissent des normes rigides, considérant la femme comme « éternelle mineure », placée sous la tutelle de son père puis de son mari. L’accès à une carrière professionnelle leur est restreint, leur rôle étant réduit à celui de mère au foyer et procréatrice.
La loi espagnole va même plus loin dans la discrimination envers les femmes mariées : sans le « permiso marital » (licence matrimoniale), une femme ne peut pas exercer une profession libérale, politique ou diplomatique, ni posséder une propriété ni voyager à l’étranger.
Le droit de vote, le mariage civil, le divorce, la contraception et l’avortement sont de nouveau prohibés. L’adultère et la désertion pour les femmes sont plus sévèrement punies que pour les hommes. Mais la prostitution reste permise !
Il faudra attendre la mort de Franco en novembre 1975 pour que le sort des femmes connaisse un changement significatif.
Transition démocratique : vers l’égalité des sexes
Déjà dans les derniers mois du franquisme, la réforme de certains articles du Code Civil et du Code du Commerce portant sur la situation juridique de la femme mariée et sur les droits et devoirs des époux modifie la réglementation en vigueur. La licence matrimoniale est supprimée ainsi que d’autres limitations. Les droits et devoirs conjugaux sont redéfinis dans un sens plus égalitaire.
L’année 1978 marque plusieurs changements importants :
● L’approbation de l’article 14 de la Constitution reconnaissant l’égalité entre les hommes et les femmes devant la loi ;
● La dépénalisation de l’adultère ;
● La légalisation de l’utilisation, la divulgation et la vente de contraceptifs.
Mais c’est la signature de la Convention de l’ONU en 1979, après plus de 30 années de travail, qui va impulser un nouvel élan vers l’égalité hommes / femmes dans le monde.

Ce texte portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est un véritable programme d’actions portant sur tous les domaines dans lesquels les femmes se voient dénier l’égalité avec les hommes. La Convention expose en détails les droits civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les femmes.
En Espagne, cela va se traduire, entre autres, par :
● La légalisation du divorce en 1981 ;
● La réforme du Code Civil portant sur les finances familiales ;
● La création de l’Institut de la Femme en 1983 ;
● La dépénalisation de l’avortement grâce à la loi organique 9/1985 de juillet 1985 ;
● La possibilité d’entrer dans l’armée à partir de 1988 et de participer à des missions internationales à partir de 1993.
Les femmes espagnoles accèdent progressivement à une indépendance économique puis juridique et leur rôle s’accroît. En 1983, elles représentent 46% des inscriptions universitaires. En 1984, 33% des espagnoles travaillent mais sont encore peu nombreuses dans les secteurs importants telle que la banque.
En 2019, le Congrès espagnol devient le plus paritaire d’Europe avec 46,7% de femmes au Congrès et 40% au Sénat.
Mais la discrimination reste encore présente dans certains domaines. À titre d’exemple, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est encore significatif, 13% dans le secteur public et 19% dans le secteur privé ; seuls 16% des femmes occupent un poste de direction ; les stéréotypes de genre persistent encore dans les moyens de communication …
Le chemin parcouru est immense et l’élan impulsé depuis le début du XXe siècle n’est pas près de s’éteindre : les Espagnoles sont partout et le féminisme bien ancré dans la société.
Portraits de femmes qui ont fait l’histoire :
Ángeles López de Ayala, (Séville 1858 - Barcelone 1926) est une journaliste, dramaturge et activiste politique considérée comme la principale féministe de la fin du XIXe siècle. Affiliée à la franc maçonnerie, elle est à l’origine de la création de la « Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona » (Société Autonome de Femmes de Barcelone) en 1892, la première organisation féministe d’Espagne. Ángeles López de Ayala est une féroce défenseuse des droits de la femme. Elle affirmait que les femmes devaient s’émanciper tant de l’Église que de la suprématie masculine. C’est elle qui organisa en 1910 la première manifestation féministe en Espagne.
Federica Montseny (Madrid 1905 – Toulouse 1994) est une femme politique, syndicaliste,

anarchiste et écrivaine espagnole. En 1931, elle devient membre de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) au sein de laquelle elle acquiert de grandes responsabilités grâce à ses talents d’oratrice. En novembre 1936, elle est nommée Ministre de la Santé et des Affaires Sociales sous la Seconde République durant la Guerre Civile, devenant ainsi la première femme ministre d’Espagne. Bien que son mandat ne dure qu’un semestre (jusqu’à mai 1937), elle planifie l’instauration de lieux d’accueil pour orphelins, de cantines pour les femmes enceintes, de maisons de reconversion pour les prostituées (liberatorios), une liste de professions ouvertes aux handicapés et demande au docteur Félix Martí Ibáñez de rédiger le premier projet de loi en faveur de l’avortement. Malheureusement, un seul lieu d’accueil pour orphelin et un seul « liberatorio » verront le jour.
À la fin de le Guerre Civile, elle se voit obligée de s’exiler en France où elle reste en résidence surveillée jusqu’à la Libération en 1944. Elle prend le nom de Fanny Germain afin de pouvoir continuer à publier des articles.

En 1977, avec l’arrivée de la démocratie en Espagne, elle retourne dans son pays pour poursuivre son activisme pour la CNT.
Elle meurt en 1994 auréolée d’un immense prestige. De nombreuses rues portent son nom dans plusieurs villes d’Espagne, notamment à Madrid et Albacete. Un jardin a même été baptisé « Jardin Federica Montseny » à Paris, rue Jeanne d’Arc en 2019.
Patricia Ortega (Madrid 1963) fille, petite-fille et sœur de militaires, elle obtient un diplôme

d’ingénieure agronome de l’Université Polytechnique de Madrid en 1987. Elle profite de la possibilité donnée aux femmes en 1988 pour entrer dans l’Armée. C’est la première femme à avoir accédé à la « Academia General Militar » (Académie Générale Militaire) de Zaragoza, et la première femme haut gradé à intégrer les Forces Armées espagnoles.
En 2009, elle devient la première femme Lieutenant-Colonel du Corps des ingénieurs polytechniciens puis elle est promue Colonel en 2016. En juillet 2019, après avoir suivi un cours pour devenir Générale de Brigade, elle obtient le grade de Générale, la première de l’histoire espagnole.
Par Sophie Castelblanque pour Madrid Accueil.
Les bons plans et conseils de l’équipe éditoriale !
Un article dans l’air du temps qui met en lumière de grandes figures féminines, libres-penseuses, talentueuses, vaillantes et audacieuses, héroïnes de l’histoire de l’Espagne et des temps modernes.
Accès direct : ici
L’édition 2023 d’El 8M, en référence au jour et au mois où elle est célébrée, donnera lieu à plusieurs marches féministes, festivals et activités à Madrid : Cette année le message porté "El 8M nos une" "Le 8M nous unit" est axé sur le consensus et l’unité pour continuer à avance dans l’égalité entre les femmes et les hommes en soulignant l’importance du dialogue et de l’entente.
- La mairie de Madrid propose un programme d’activités dans les espaces de l’égalité : en savoir plus
- El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Institut de la Femme et pour l’Égalité des chances) organise la 19ème édition du festival de la création féminine Ellas Crean du 2 au 30 mars. Un festival qui vise à valoriser le travail des femmes dans le monde de la culture avec un programme riche de musique, danse, théâtre, cinéma, arts visuels. En savoir plus : ici
Les œuvres à découvrir ou à redécouvrir :
Cinéma :
"La Novia" (2015) de Paula Ortiz, un film qui aborde le thème de la violence de genre.
"Tout sur ma mère" (1999) de Pedro Almodovar, un film qui met en avant les problèmes liés à l’identité de genre.
"Volver" (2006) de Pedro Almodovar, un film qui explore les thèmes de la famille et de la maternité.
Séries :
"Las chicas del cable" (2017-2020) de Ramon Campos et Gema R. Neira, une série qui se déroule dans les années 1920 et qui aborde la place des femmes dans le monde du travail et de la société.
"Vis a Vis" (2015-2019) de Ivan Escobar, une série qui se déroule dans une prison pour femmes et qui aborde les problèmes de la condition féminine en prison.
Romans :
"La voix du silence" (1979) de Soledad Puertolas, un roman qui explore la place des femmes dans la société espagnole de l’époque.
"Nada" (1944) de Carmen Laforet, un roman qui aborde les difficultés rencontrées par une jeune femme dans l’Espagne de l’après-guerre civile.
Autres sources pour en savoir plus sur :
- Les droits de la femme en Espagne « Los derechos de las mujeres en España » : es.wikipedia
- La journée internationale de la femme « El Día Internacional de la Mujer » : es.wikipedia
Karine, Cécile & Eve - Equipe éditoriale MA.





Partager